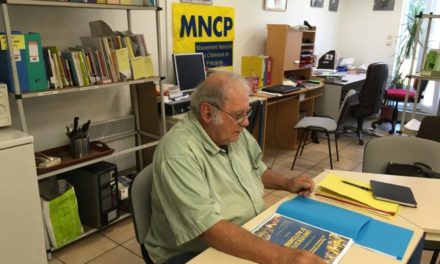La grève serait-elle devenue tabou dans notre belle démocratie ? L’absence de toute information objective, voir la manipulation de l’opinion publique sur les raisons des grèves, sont l’une des caractéristiques majeures de la sphère médiatique. Un phénomène qui avait été analysé avec pertinence lors d’un débat organisé par notre association avec le sociologue Jean-Marie Pernot.

Il en est ainsi pour les conflits en cours à France Télévision et Radio France, services publics de l’audio-visuel. En guise d’information, de laconiques messages tournent en boucle : « En raison d’un mouvement de grève à l’appel d’une majorité de syndicats, nous ne sommes pas en mesure de présenter nos programmes habituels ». Nous ne saurons rien de plus sur les motivations d’une grève, reconduite chaque jour par l’assemblée générale du personnel, en grève depuis le mercredi 18 mars. A l’heure où ces lignes sont écrites, nous en sommes donc au 7e jour de grève à Radio France. Il est paradoxal, pour ne pas dire étrange, qu’aucun journal télévisé, aucune émission radiophonique, ne traite de la question. Et que dire de l’information écrite, totalement muette sur le sujet. Absolument rien dans les journaux détenus par le Crédit Mutuel, alors que le bureau des informations générales, basé à Paris, est à la source ! L’exception confirmant la règle, L’Humanité y consacre un article dans son édition du 23 mars. Il faut se rendre sur le site des syndicats de Radio France pour comprendre ce qui est à l’origine d’un mouvement d’une telle durée.
Dans les faits, la question des moyens financiers attribués par l’État pour assurer un service public de qualité se pose avec acuité. Un problème qui n’est pas neuf. Car c’est bien d’une cure d’austérité permanente dont souffrent ces entreprises. L’exemple de Radio France est éclairant. De 2010 à 2015, l’État, quel que soit le gouvernement en place, a imposé des économies à hauteur de 87 millions d’euros. Le prochain contrat d’objectifs prévoit de nouvelles mesures d’économies de 50 millions d’euros, qui se soldent par un déficit de 21,3 millions d’euros. L’austérité d’État impose donc des conditions draconiennes d’exploitation. L’adaptation à ces contraintes entraîne invariablement des mesures sur l’emploi, avec une baisse de 10% des effectifs, la remise en cause des statuts professionnels et des conventions collectives, le recours aux emplois précaires et aux CDD, l’intensification des tâches et le développement de la polyvalence, l’abandon de missions de services publics et la restructuration de stations satellites. Pour finaliser ce tour d’horizon, citons les menaces qui pèsent sur de nombreuses activités, dont les formations musicales feraient les frais, la tentative d’externaliser des activités assurés en interne, tout en développant des services permettant la rentrée de nouvelles recettes (location d’espaces pour les défilés de mode, de studios pour des fêtes privées, de personnel pour en assurer l’après-vente !). On peut donc en déduire que Radio France est confronté à une logique de privatisation rampante, et pose la question de l’avenir du service public radiophonique. Le tout dans un silence assourdissant de la ministre de tutelle, Fleur Pellerin.
Notre association ayant vocation à soutenir le pluralisme de l’information et le débat citoyen, nous voulons mettre l’accent sur un point qui nous semble déterminant quant à la vocation du service public. Nous avons dénoncé, à de multiples reprises, les choix éditoriaux en œuvre dans la quasi-globalité des médias, y compris de services publics. Quand la crise de la démocratie s’exacerbe, nous sommes en droit d’avoir des exigences particulièrement élevées en matière d’expression du pluralisme et de la diversité des opinions. Nous sommes très loin du compte. On se rappelle encore de l’éviction, pour raison politique, des polémistes Stéphane Guillon et Didier Porte par le pouvoir sarkozyste, sans oublier la modification des grilles de programmation, préjudiciable à une émission aussi populaire que celle de Daniel Mermet. Les experts économistes de la frange libérale occupent le devant de la scène en permanence, sans jamais que le débat contradictoire ne soit à l’ordre du jour et que nous assistons, impuissants, à un étrange jeu de rôle entre éditorialistes de la sphère privée du Figaro, du Monde, des Echos, et les services publics d’information. Il en va de même dans l’expression politique, chasse gardée de l’UMP et du PS, alors que la promotion du FN atteint un niveau scandaleux. Au-delà des aspects financiers et économiques, elle est là, la vraie crise de l’audio-visuel public, quand sa mission d’animateur du débat public est à ce point confisqué au profit d’intérêts de classe. Assurément, un terrain en friche que tous les démocrates seraient bien inspirés de conquérir.
Hubert Strauel