Si le mythe est bien une « construction imaginaire à vocation explicative de pratiques sociales en fonction des valeurs fondamentales d’une communauté à la recherche de sa cohésion » (Wikipedia), alors le revenu de base « d’existence » ou « universel » en est un.
L’exposé suivi d’un débat de Denis Durand économiste à la revue Economie et politique qui s’est déroulé à l’instigation de l’Alterpresse 68 à l’auberge de jeunesse de Mulhouse ce 31 janvier a contribué à enrichir la réflexion sur un sujet devenu un « marqueur » important des projets des candidats en ces temps de campagnes politiques.
Revenu de base, Revenu universel garanti, de quoi s’agit – il ? Quelques rappels préalables
Revenu universel et donc versé à tous sans conditions, revenu individuel ou conditionné par des situations familiales comme le prévoient les minima sociaux actuels, revenu inconditionnel ou lié à des contreparties exigées par l’autorité publique, autant de visions du R.U.
Vieille utopie versions Thomas More au 16° siècle ou Thomas Paine, révolutionnaire franco – américain du 18ème, version Martin Luther King ou version Milton Friedman économiste ultra – libéral, version André Gorz, philosophe progressiste… autant d’approches parmi bien d’autres du R.U.
C’est évidemment la profondeur des bouleversements économiques et sociaux actuels, la remise en question rapide de notre modèle social, l’explosion des inégalités et les inquiétudes de ceux qui ne sont pas – plus – « inclus » dans notre société, les évolutions technologiques majeures, les craintes sur la nature et le volume global de l’emploi disponible dans nos sociétés, l’absence de visibilité à moyen, voire à court terme, qui expliquent l’ampleur des réflexions actuelles autour du R.U.
R.U : avantages, risques, questions
Le revenu universel serait un moyen pour notre société de s’adapter à une situation économique et sociale globale où seule une fraction de la population en âge de travailler produirait des richesses au sein d’une économie monétarisée, dans le cadre d’un emploi rémunéré.
Mais les gains de productivité, le numérique, la robotisation, sont loin d’être unanimement admis comme facteurs de suppressions massives d’emplois; nombre d’études et de prévisions sur le sujet s’avèrent contradictoires.
De même la vision de la « machine » Moloch détruisant des emplois renvoie-t-elle aux grandes peurs des périodes d’industrialisation et de bouleversements techniques; les « luddites » du 19e siècle, par exemple, étaient des « briseurs de machines » causes supposées de destructions d’emplois…
Autre idée force : le travail humain serait seul générateur de richesses « monétarisables » au-delà des intrans nécessaires pour produire biens et services; les heures de loisirs, le travail bénévole sous toutes ses formes ne seraient donc pas productives de « valeur » et un revenu servi pour favoriser leur développement fleure encore l’hérésie, comme et le « droit à la paresse » évoqué par le gendre de Kart Marx.
La création d’un R.U permettrait à l’Etat de simplifier, voire d’abolir, ses tâches de contrôles et d’assistances sociales, la stigmatisation des pauvres et des exclus du travail serait moindre, mais quid de l’impact d’un tel revenu garanti sur les valeurs d’une société du » travail » ?
Autres questions: un R.U facteur de pression positive sur la qualité et la rémunération des emplois proposés par l’économie monétarisée à des individus moins enclins à accepter « n’importe quoi » ou facteur de baisse des salaires pour cause de R.U garanti?
Un positionnement moins « low cost » dans la division internationale du travail pour le/les pays concernés ou un risques de délocalisations d’emplois accrue dans une division du travail et des chaînes de valeur internationalisées ?
La lancinante question du financement:
Un revenu garanti à 500 euros mois – quasiment le RSA actuel pour un adulte isolé sans enfant – ou de 1000 euros mois – chiffre souvent cité comme « convenable » – généreraient des besoins de financement égaux à 18% du PIB ou à 36% alors que les minima sociaux en vigueur représentent environ 1,1% du PIB (selon des calculs à valeur plus que relative toutefois; s’agit – il de sommes versées imposables ?pour quelle durée de montée en puissance du dispositif ?avec quelles substitutions à tout ou partie des aides/allocations existantes ? Et quid des allocation chômages, des retraites ?
Versement du R.U avec ou sans réduction drastique d’autres formes de dépenses publiques ? Quelles évolutions induites pour la protection sociale?
On aura compris que le coût du le revenu de base, et pour en rester à l’essentiel des 28 millions de Français qui perçoivent très peu de prestions sociales et qui occupent un emploi rémunéré, est une variable extrêmement capricieuse…
Entre la mise à disposition d’un montant individuel garanti à chaque individu et l’obligation pour chacun de gérer seul ses situations de vie, santé, éducation, transport, logement… et le filet social d’une société du « care » revisitée le fossé pourrait s’avérer quasi infranchissable et le concept prendre des signification très différentes, voire totalement contradictoires.
La réflexion et les propositions de Denis Durand
Denis Durand avait choisi en introduction du débat de présenter un point du vue critique sur une version du concept de RU, « vraie fausse bonne idée » et d’insister sur la nécessaire primauté du projet politique sous tendant le R.U, de souligner la vision d’un RU situé dans une société où « s’indigner ne suffit pas et qui doit se structurer autour d’une vision de justice sociale ».
Son insistance sur la dimension de sécurisation globale tout au long de la vie professionnelle, des parcours construits tout au long de la vie, comme sur une vision de « syndicalisme » global.
Et son insistance sur la question du nécessaire contrôle des entreprises, de leurs emplois et de leurs investissements, en particulier par leurs instances élues comme les comités d’entreprise renforce cette approche.
Poser la question du pouvoir économique, de la capacité de décision – celui de bloquer des licenciements économiques, celui d’imposer des financements bancaires pour des entreprises en évolution – sont pour lui les vraies garanties d’une sécurisation des vies et des parcours personnels.
La question de la formation tout au long de la vie « au cas où », sans oublier le volet « réduction du temps de travail » comme deuxième partie du dyptique de l’approche proposée sont complétées par des propositions sur la rémunération des chômeurs contre un travail socialement utile.
Quand au financement, les pistes de réponse exposées privilégieraient la lutte contre l’évasion fiscale, les paradis fiscaux, la récupération d’un part des dividendes du CAC 40, la résistance aux contraintes générées par l’Union européenne.
Les deux formes de revenu universel qu’il faut absolument éviter, selon le conférencier sont :
- S’il est destiné à chaque citoyen, ce serait de le financer en supprimant toutes les prestations et couvertures sociales existantes, déshabillant donc Pierre pour habiller Paul…
- S’il est adapté aux seules possibilités financières disponibles dans le budget de l’Etat, il serait distribué à des catégories bien particulière (jeunes, bas-salaires, privés d’emplois…) et perdrait donc son caractère « universel ».
Les questions posées par une salle largement acquise à ces analyses ont encore élargi le champ des interrogations et des craintes:
Risques de « détricotage » du Code du Travail par des entreprises dégagées grâce au R.U de leurs responsabilités sociales, risques de régression massive du salariat et des conditions de défense collective des salariés par l’action syndicale et menaces sur l’organisation même de la protection sociale basée sur l’entreprise, minoration de l’impératif politique et sociétal de lutte contre le chômage, risques liés à des organisations économiques privilégiant l’individuel sur le collectif, des auto-entrepreneurs « ubérisés » aux allocataires/bénéficiaires du R.U …
….mais aussi impact positif du R.U souligné par des intervenants : aide aux capacités inventives de bénéficiaires ainsi « sécurisés », aide aux micro-projets qui peuvent représenter des potentiels économiques réels, prise en compte de la dignité des personnes libérées de contrôles administratifs qui les stigmatisent, facilitation de projets associatifs, d’économie collaborative, d’économie distributive – souvent à dimension locale.
De quoi le Revenu universel garanti est il donc le nom ?
D’une démarche pour la prise de pouvoir dans l’entreprise d’autres groupes/classes sociales que celles que représenteraient les « actionnaires » dans une version actualisée des réflexions autogestionnaires des années 70 ?
D’un outil ambitieux de répartition plus juste des richesses ?
D’un outil pour la prise en compte significative des pauvres, des exclus, des précaires ou d’exclusion à peu (ou beaucoup?) de frais ?
D’une réponse à l’évolution d’une organisation économique globale devenue désormais inéluctable avec trop de demandeurs d’emplois chassant après trop peu de postes de travail ?
D’une aide à la libération d’énergies, notamment entrepreneuriales ?
D’un facteur de collaborations locales, au plus près des bassins de vie?
D’un levier de transformation sociétale sociale majeure, d’une orientation politique adaptée au nom de valeurs redéfinies, loin du productivisme ou d’un alibi pour un productivisme libéral ?
Les réponses dépendront d’intérêts de groupes sociaux, de leurs valeurs plus ou moins partagées pour « faire société », de la capacité de notre modèle à gérer ses tensions, ses contradictions, de plus en plus marquées.
C’est en ce sens que le Revenu universel répond très exactement à la définition du « mythe » précitée.
Mais peut-on espérer qu’il devienne aussi facteur clé d’un nouvel universalisme qui redéfinirait le concept de droits de l’Homme? Qu’il apporterait une nouvelle dimension philosophique intégrant toutes les dimensions de l’engagement politique dans notre société qui doute et où montent des colères ?
En somme le revenu universel participerait-il du concept de « communs »*, des services publics aux facteurs environnementaux, aux conditions du débat démocratique, à l’égalité des chances, aux réponses sociétales et politiques basées sur des valeurs communes dont les premières restent la solidarité et le respect des biens communs ?
Christian Rubechi
*Voir la Revue Hommes & Libertés de la Ligue des Droits de l’Homme – Décembre 2016


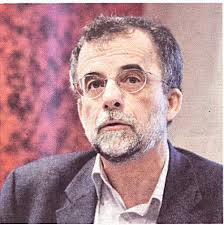

![[En accès libre] Moyen-Orient : plaider la paix sans relâche, surtout quand l’hystérie tient lieu de débat public…](https://www.alterpresse68.info/wp-content/uploads/2018/09/Detruire-Gaza-440x264.jpg)























































